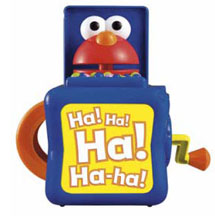Une interview à propos de mon livre, La grande invasion, sur le site de Denis Lebioda, contaminations-chimiques.info.
1 – Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage ?
Comme beaucoup de gens, je me posais des questions sur les substances chimiques qui partagent notre quotidien. En cherchant à me documenter – pour ma gouverne personnelle dans un premier temps–, j’ai été frappée par la différence sidérante entre la masse d’informations disponibles et le degré de conscience de la population, proche du néant en France, sur l’ampleur des enjeux.
Dans notre pays, le mot “pollution” ne semble concerner que la pollution extérieure. On parle volontiers des dioxines ou des pesticides en agriculture. Mais quand il s’agit d’évoquer la pollution à l’intérieur de nos habitations, dans notre nourriture, nos détergents ou nos produits d’hygiène, le sujet suscite une sorte de nonchalance moqueuse : “Oui, mais alors on ne peut plus rien faire et de toute façon, on va tous mourir” ricanent certains.
Par ailleurs, nos médias ne parlent presque jamais des avancées de la science sur cette question. Pas plus qu’ils ne suivent les “affaires” de santé publique dont se sont emparés les grands médias américains et qui sont pourtant les mêmes chez nous. Qui en France sait que le bisphénol-A, contenu dans le plastique polycarbonate et la résine epoxy (qui servent à fabriquer biberons, récipients de cuisine, revêtements intérieurs des boîtes de conserve etc) est l’objet d’une controverse enragée entre scientifiques, instances réglementaires et industrie ?
J’ai donc voulu mener une enquête journalistique qui permettrait d’expliquer la problématique sous tous ses aspects, l’axe principal étant de faire l’état des lieux des connaissances scientifiques les plus récentes.
2 – Quels sont les points / informations / témoignages qui vous ont le plus touchée ?
Au cours de cette enquête, j’ai pu constater que les scientifiques exprimaient une réelle inquiétude pour la santé de la population. Ils ont pourtant le sentiment de ne pas être suffisamment entendus par les pouvoirs publics. Leur principal problème réside dans le fait qu’il est très difficile de prouver scientifiquement et de manière définitive la toxicité sur le long terme d’une substance donnée.
Les chercheurs recommandent l’application du principe de précaution. L’industrie leur répond “absence de preuves”. Certains scientifiques n’hésitent pas à qualifier cette exposition chimique généralisée d’expérience menée à grande échelle. Comme le chercheur Philippe Grandjean, pour qui réunir les preuves consiste à “étudier ce qui arrive à nos enfants”. Seuls les pouvoirs publics peuvent agir et trancher.
Mais ce genre de décisions remet profondément en cause un certain nombre de principes qui ont construit et organisent désormais notre monde moderne.
3 – A votre avis, que peuvent faire les citoyens – consommateurs pour échapper à cette contamination généralisée ?
Il est impossible de s’extraire de la chimie dans un monde qui est chimique. À moins « de revenir au temps où les gens s’habillaient en peaux de bêtes », comme le dit avec humour le chercheur suédois Per Eriksson.
Les scientifiques que j’ai interrogés estiment cependant que nous pouvons limiter notre exposition à certaines substances chimiques avec des gestes simples. C’est d’ailleurs l’objet de l’épilogue, qui explique ce que ces scientifiques ont eux-mêmes changé dans leur mode de vie.
Ne pas utiliser d’insecticides dans sa maison, ne pas réchauffer de nourriture au micro-ondes dans un récipient en plastique, être particulièrement vigilant pendant une grossesse et au cours des premières années de la vie de son enfant etc. Tous disent : « Ne vous servez que des produits dont vous avez vraiment besoin. Et quand vous le faites, n’en utilisez que le strict minimum. » Ils regrettent par ailleurs que les produits biologiques et/ou écologiques demeurent un luxe.
Pour ma part, je pense que les citoyens peuvent exercer une pression indirecte très forte sur l’industrie en modifiant leurs habitudes de consommation et en étant plus exigeants envers l’information qu’on leur donne sur les produits qu’ils achètent.
[18 janvier 2008]
 Une bonne bouffée d’air pollué, et l’ADN du sperme des souris mute. C’est la conclusion d’une étude menée par une équipe de chercheurs d’Ottawa (Canada) et de l’Université de Maastricht (Pays-Bas). Dans
Une bonne bouffée d’air pollué, et l’ADN du sperme des souris mute. C’est la conclusion d’une étude menée par une équipe de chercheurs d’Ottawa (Canada) et de l’Université de Maastricht (Pays-Bas). Dans 

 Les composés perfluorés sont au total 175 à avoir des noms imprononçables. Et depuis plusieurs années, les scientifiques sont intrigués par une question : pourquoi polluent-ils la planète entière ? Ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi de très importantes quantités de perfluorés se promènent dans la nature. Car ces produits quasi-magiques ont aussi cela de particulier qu’ils sont ubiquitaires et persistants dans l’environnement. PFOS et PFOA sont dans notre sang, la nature, l’eau et les organismes des animaux sauvages, jusqu’au pôle Nord. Jusqu’aux ours blancs. De nos jours, même le cordon ombilical des nouveaux-nés en contient. Dernier détail : en 2005,
Les composés perfluorés sont au total 175 à avoir des noms imprononçables. Et depuis plusieurs années, les scientifiques sont intrigués par une question : pourquoi polluent-ils la planète entière ? Ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi de très importantes quantités de perfluorés se promènent dans la nature. Car ces produits quasi-magiques ont aussi cela de particulier qu’ils sont ubiquitaires et persistants dans l’environnement. PFOS et PFOA sont dans notre sang, la nature, l’eau et les organismes des animaux sauvages, jusqu’au pôle Nord. Jusqu’aux ours blancs. De nos jours, même le cordon ombilical des nouveaux-nés en contient. Dernier détail : en 2005,  Dans son analyse, livrée le 20 décembre 2007, l’AFSSA s’est principalement soucié du sort des abeilles, dont les populations sont décimées depuis plusieurs années [
Dans son analyse, livrée le 20 décembre 2007, l’AFSSA s’est principalement soucié du sort des abeilles, dont les populations sont décimées depuis plusieurs années [ Quant au triclosan, qu’on a plus de chances de détecter dans les dentifrices et les savons, il cause déjà des dégâts dans la nature : il est insuffisamment filtré par les stations d’épurations. À l’automne 2006, l’équipe de
Quant au triclosan, qu’on a plus de chances de détecter dans les dentifrices et les savons, il cause déjà des dégâts dans la nature : il est insuffisamment filtré par les stations d’épurations. À l’automne 2006, l’équipe de